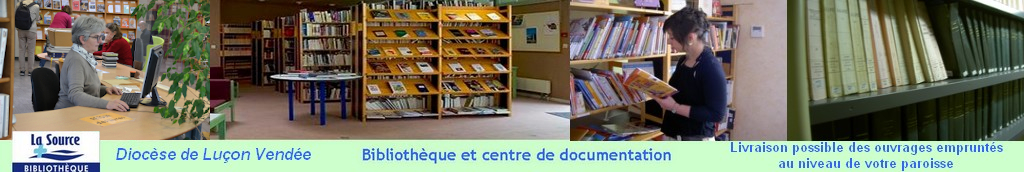La Médiathèque La Source sera fermée exceptionnellement le mercredi 4 février 2026.

[article]
| Titre : |
Israélisme et christianisme au temps des réformes : les conditions théologico-politiques de l'autonomie moderne. Un cas typique : l'interprétation royaliste du 1er livre de Samuel (8, 9-20) |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Bernard Bourdin, Auteur |
| Année de publication : |
2017 |
| Article en page(s) : |
p. 57-70 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Gauchet, Marcel (1946-....) |
| Résumé : |
La thèse de Marcel Gauchet selon laquelle le christianisme est «la religion de la sortie de la religion», et à ce titre fondatrice de l’autonomie politique, ne saurait s’expliquer sans en passer par une théorie historique du déclin de la dépendance de l’organisation des sociétés humaines par rapport à tout modèle d’hétéronomie religieuse. Mais le moment chrétien de la sortie de la religion est précédé par la Révélation mosaïque, première religion de la transcendance et de la réduction de l’hétéronomie (ou de l’altérité). Cette théorie philosophique qui prend son assise dans une histoire politique de la religion nécessite, pour ce motif, d’être vérifiée dans le champ de l’histoire des idées théologico-politiques du christianisme. C’est particulièrement topique dans le contexte des Réformes du XVIe siècle. En vertu de son recours au texte fondateur de la royauté israélite, le calvinisme politique du roi Jacques Stuart (1566-1625) réalise une opération paradoxale en fondant l’autonomie du pouvoir monarchique sur la base d’une théologie de la toute-puissance de Dieu. Ce cas de figure, parmi bien d’autres dans le contexte des Réformes, vient accréditer par l’histoire la thèse de Marcel Gauchet du paradoxe des religions de la transcendance (israélisme et christianisme): l’hétéronomie religieuse comme mise en œuvre théologico-politique de l’autonomie moderne. (editeur) |
in Revue biblique > N° 124-1 (janvier 2017) . - p. 57-70
[article] Israélisme et christianisme au temps des réformes : les conditions théologico-politiques de l'autonomie moderne. Un cas typique : l'interprétation royaliste du 1er livre de Samuel (8, 9-20) [texte imprimé] / Bernard Bourdin, Auteur . - 2017 . - p. 57-70. Langues : Français ( fre) in Revue biblique > N° 124-1 (janvier 2017) . - p. 57-70
| Mots-clés : |
Gauchet, Marcel (1946-....) |
| Résumé : |
La thèse de Marcel Gauchet selon laquelle le christianisme est «la religion de la sortie de la religion», et à ce titre fondatrice de l’autonomie politique, ne saurait s’expliquer sans en passer par une théorie historique du déclin de la dépendance de l’organisation des sociétés humaines par rapport à tout modèle d’hétéronomie religieuse. Mais le moment chrétien de la sortie de la religion est précédé par la Révélation mosaïque, première religion de la transcendance et de la réduction de l’hétéronomie (ou de l’altérité). Cette théorie philosophique qui prend son assise dans une histoire politique de la religion nécessite, pour ce motif, d’être vérifiée dans le champ de l’histoire des idées théologico-politiques du christianisme. C’est particulièrement topique dans le contexte des Réformes du XVIe siècle. En vertu de son recours au texte fondateur de la royauté israélite, le calvinisme politique du roi Jacques Stuart (1566-1625) réalise une opération paradoxale en fondant l’autonomie du pouvoir monarchique sur la base d’une théologie de la toute-puissance de Dieu. Ce cas de figure, parmi bien d’autres dans le contexte des Réformes, vient accréditer par l’histoire la thèse de Marcel Gauchet du paradoxe des religions de la transcendance (israélisme et christianisme): l’hétéronomie religieuse comme mise en œuvre théologico-politique de l’autonomie moderne. (editeur) |
|